Quatre experts révèlent comment l’intelligence artificielle (IA) transforme la surveillance des maladies et la pratique vétérinaire
Dans une région isolée de Californie, un centre de réhabilitation de la faune sauvage télécharge des notes cliniques de routine concernant un aigle blessé présentant des signes de maladie neurologique. En l’espace de quelques heures, un système d’IA signale ce cas ainsi que des rapports similaires provenant de tout l’Etat de Californie, détectant un schéma inhabituel qui pourrait signaler l’apparition d’une épidémie, plusieurs semaines avant que les méthodes de surveillance traditionnelles ne s’en aperçoivent. Ce scénario, devenu réalité grâce à des plateformes comme WildAlert, une plateforme de surveillance en ligne, illustre la façon dont l’IA révolutionne la santé animale, qui passe d’une discipline réactive à une discipline proactive.
La transformation va bien au-delà des cas individuels. Qu’il s’agisse d’élevages de bovins dans des communautés rurales ou de Services vétérinaires nationaux confrontés à l’émergence de maladies liées au climat, les technologies de l’IA redéfinissent la manière dont nous détectons, prévenons et répondons aux menaces qui pèsent sur la santé animale. Toutefois, cette révolution technologique est porteuse d’opportunités sans précédent et de défis importants qui exigent une gestion prudente.
Le paysage actuel de l’IA en santé animale
L’application de l’IA à la santé animale couvre un éventail remarquablement diversifié de technologies et de cas d’utilisation. À la pointe de la surveillance des maladies, les chercheurs ont mis au point des systèmes sophistiqués qui transforment le chaos des données vétérinaires du monde réel en intelligence exploitable.
« Nous tirons parti de l’intelligence artificielle pour renforcer la surveillance des maladies chez la faune sauvage en améliorant notre capacité à détecter les signes précoces de menaces sanitaires dans les populations d’animaux sauvages », explique Terra Kelly, chercheuse en santé de la faune sauvage qui participe à la mise au point de WildAlert. Le système utilise le traitement du langage naturel pour extraire les informations cliniques des dossiers médicaux en texte libre, convertissant les notes vétérinaires informelles en données standardisées qui peuvent être analysées dans le temps, sur différentes zones géographiques et entre les espèces.
Cette approche permet de relever un défi fondamental en médecine vétérinaire : une grande partie des informations précieuses sur la santé des animaux existe dans des formats non structurés. La surveillance traditionnelle repose largement sur des diagnostics définitifs, mais l’IA facilite ce que les chercheurs appellent la surveillance « prédiagnostique », c’est-à-dire l’identification de schémas avant que les maladies ne soient officiellement confirmées.
De son côté, Pranav Pandit, professeur adjoint d’épidémiologie vétérinaire à l’École de médecine vétérinaire de l’Université de Californie, Davis, explique comment les chercheurs repoussent les limites des applications de l’IA dans les contextes épidémiologiques et cliniques. À l’Université de Californie, Davis, des algorithmes d’apprentissage automatique sont utilisés pour modéliser le risque de maladie à l’aide de prédicteurs climatiques, ce qui permet d’établir des prévisions allant de la maladie respiratoire bovine à la répartition future des réservoirs de maladies zoonotiques, explique-t-il. Des modèles de vision par ordinateur sont formés pour détecter les signes précoces de la maladie par imagerie radiographique, mais Pandit souligne que ces approches sont encore en cours de validation.
La portée de la technologie s’étend au-delà des applications cliniques directes. Les développeurs de plateformes de prospective utilisent des agents d’IA pour analyser et synthétiser les signaux de changement à l’échelle mondiale. Jens Hansen, directeur de stratégie et de communication de la plateforme mondiale d’intelligence prospective Shaping Tomorrow, explique comment le maintien de bases de données contenant plus de 150 000 déclarations récentes sur l’avenir aide les Services vétérinaires à anticiper les risques zoonotiques et à se préparer aux perturbations liées au climat.
Même dans les environnements opérationnels, les outils d’IA deviennent indispensables. À la Wildlife Conservation Society, le directeur exécutif Health Chris Walzer explique comment les équipes utilisent régulièrement des plateformes telles que ChatGPT pour la rédaction stratégique et l’extraction de données. Cependant, les équipes de recherche s’appuient sur des outils d’analyse documentaire alimentés par l’IA pour identifier rapidement les lacunes en matière de connaissances et affiner les propositions de recherche.

©FG Trade
Surmonter les défis de la mise en œuvre
Malgré ces avancées, le chemin vers l’adoption de l’IA dans le domaine de la santé animale est semé d’obstacles techniques et institutionnels. Le défi le plus important réside dans la qualité et la disponibilité des données, un problème qui affecte tout, de la formation des modèles à la mise en œuvre dans le monde réel.
« Les dossiers médicaux de réhabilitation de la faune sauvage contiennent souvent des données non structurées et non normalisées », note Kelly. « Nous avons procédé à une formation approfondie de notre modèle de traitement du langage naturel afin qu’il reconnaisse les termes spécifiques au domaine, les abréviations et les diverses façons dont les présentations cliniques sont enregistrées ».
Ce problème de données est particulièrement aigu dans les environnements où les ressources sont limitées. « L’un des principaux défis réside dans la disponibilité d’ensembles de données harmonisées de haute qualité, en particulier dans les régions sous-financées où les capacités sont limitées », observe Walzer. La disparité dans la disponibilité des données risque de créer un fossé IA qui pourrait exacerber les inégalités existantes dans les services de santé animale.
Au-delà des défis techniques, la mise en œuvre de l’IA se heurte à une résistance institutionnelle qui trouve son origine dans les différences fondamentales entre l’apprentissage automatique et les approches épidémiologiques traditionnelles. « Les cadres épidémiologiques traditionnels valorisent l’interprétabilité des modèles, qui est souvent limitée dans les approches d’apprentissage automatique », explique Pandit. Cela peut entraver l’adoption et le financement.
Le défi s’étend à la constitution des équipes interdisciplinaires nécessaires à la réussite du développement de l’IA. Pour être efficaces, les outils d’IA nécessitent la collaboration de vétérinaires, d’experts en faune sauvage, d’épidémiologistes, de statisticiens et de spécialistes de l’IA : une combinaison qui peut être difficile à réunir et à coordonner.
Le plus important est peut-être que la vitesse du développement technologique dépasse souvent la capacité d’adaptation des institutions. « Le rythme d’adoption des technologies dépasse la capacité des cadres réglementaires et institutionnels à suivre, ce qui crée des lacunes en matière de surveillance et de mise en œuvre », prévient Walzer.
L’un des principaux défis réside dans la disponibilité d’ensembles de données harmonisées de haute qualité, en particulier dans les régions sous-financées où les capacités sont limitées.
Chris Walzer
Mesurer le succès et l’impact
Malgré ces défis, les applications de l’IA dans le domaine de la santé animale apportent des améliorations mesurables dans de nombreux domaines. Les avantages les plus immédiats concernent l’efficacité et la rapidité d’analyse.
Les systèmes de surveillance assistés par l’IA ont « considérablement réduit le temps nécessaire à l’analyse de l’horizon, à l’élaboration de scénarios et à la préparation de notes d’information sur les politiques », explique Hansen. Pour les vétérinaires, cela se traduit par une identification plus rapide des risques intersectoriels et par une prise de décision mieux informée sur la prévention des maladies et l’allocation des ressources, ajoute-t-il.
La capacité de la technologie à exploiter les sources de données existantes représente une autre avancée significative. Plutôt que de nécessiter des systèmes de collecte de données entièrement nouveaux, les outils d’IA peuvent extraire de la valeur d’informations qui existent déjà, mais qui étaient auparavant sous-utilisées. « Les technologies d’IA nous ont permis d’exploiter les données cliniques existantes sur la faune sauvage pour compléter les efforts de surveillance active des maladies », note Kelly. « Cela nous permet de surveiller les maladies de la faune sauvage sans dépendre uniquement de l’échantillonnage actif sur le terrain, ce qui rend la surveillance plus complète et plus efficace en termes de ressources. »
Dans le domaine de la recherche, l’IA a accéléré les processus fondamentaux. Walzer souligne que les examens des politiques et les cycles d’élaboration des subventions, qui prenaient autrefois des semaines, peuvent désormais être réalisés en quelques jours, ce qui permet aux organisations de répondre plus rapidement aux questions émergentes, tandis que des analyses documentaires plus rapides permettent aux chercheurs d’identifier les lacunes en matière de connaissances, ainsi que d’affiner les propositions plus rapidement.
Plus important encore peut-être, les outils d’IA permettent de détecter plus tôt les épidémies potentielles. Les systèmes de détection d’anomalies basés sur l’apprentissage automatique peuvent mettre en évidence des schémas inhabituels, tels que des augmentations de cas neurologiques au sein d’espèces ou de régions particulières, avant même que des diagnostics définitifs ne soient posés. Cette capacité fait passer la santé animale d’une approche réactive à une approche proactive, ce qui permet d’éviter que de petits problèmes ne se transforment en crises majeures.
Des implications plus larges pour la société
Les implications sociétales de l’IA dans le domaine de la santé animale vont bien au-delà de la pratique vétérinaire. Dans le meilleur des cas, l’IA peut renforcer les systèmes interconnectés qui protègent à la fois la santé animale et la santé humaine, en soutenant l’approche « Une seule santé » qui reconnaît les liens entre la faune sauvage, le bétail et les maladies chez les humains.
« L’IA peut améliorer la surveillance des maladies, le bien-être des animaux et les systèmes d’alerte précoce, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et la santé animale en général », observe Pandit. La technologie favorise une évolution vers des pratiques vétérinaires plus durables et préventives, réduisant potentiellement la dépendance à l’égard de traitements tels que les antimicrobiens, qui peuvent contribuer à la résistance.
Dans le cadre de ce que Walzer appelle « la réalité complexe de la polycrise mondiale », les outils d’IA aident à intégrer les connaissances entre les secteurs et les disciplines. Cette capacité est particulièrement précieuse pour relever des défis tels que le changement climatique, qui affecte la santé animale par des voies complexes et interconnectées que les humains peuvent difficilement suivre s’ils ne font pas appel à une assistance technologique.
Toutefois, les risques sont tout aussi importants. « Les risques comprennent les algorithmes opaques, l’inégalité numérique et l’utilisation potentiellement abusive des données », prévient Hansen. Le problème n’est pas seulement technique, mais fondamentalement lié au pouvoir et à l’équité. Comme le dit Walzer : « Il est d’une importance capitale de savoir qui contrôle et définit les objectifs de l’IA ».
Le risque d’ancrer les préjugés existants est particulièrement important. Si les systèmes d’IA sont formés principalement à partir de données provenant de milieux bien dotés en ressources, ils risquent d’être peu performants dans les contextes où l’on a le plus besoin de services de santé animale améliorés. « Une confiance excessive dans l’IA, en particulier lorsque les modèles sont formés sur des ensembles de données biaisées, peut conduire à des prédictions erronées et à des décisions malavisées », prévient Pandit.
Une confiance excessive dans l’IA, en particulier lorsque les modèles sont formés sur des ensembles de données biaisées, peut conduire à des prédictions erronées et à des décisions malavisées.
Pranav Pandit
Façonner l’avenir des Services vétérinaires
À l’avenir, les experts estiment que l’IA transformera fondamentalement le mode de fonctionnement des Services vétérinaires, promettant d’améliorer à la fois l’efficacité et l’efficience des systèmes de santé animale.
« L’IA transformera les Services vétérinaires en institutions davantage axées sur l’anticipation et les données », prédit Hansen. « Les analyses en temps réel et les modèles prédictifs peuvent permettre des interventions plus précoces et une allocation plus intelligente des ressources ».
La vision va au-delà de la simple automatisation et englobe une intégration plus sophistiquée de l’IA avec l’expertise humaine. « La plus grande valeur ne viendra pas de l’automatisation seule, mais de la façon dont l’IA complète le jugement humain et aide à intégrer la prévoyance à long terme dans les systèmes de santé animale », ajoute Hansen.
Pour les Services vétérinaires nationaux, en particulier ceux qui s’occupent de la surveillance de la santé de la faune sauvage, l’IA représente une opportunité de faire plus avec des ressources limitées. « L’IA peut devenir un outil important pour les Services vétérinaires modernes, en particulier dans les programmes nationaux de santé de la faune sauvage où la surveillance manque souvent de ressources », déclare Kelly. Elle peut automatiser le traitement fastidieux des données, hiérarchiser les alertes et faciliter la prise de décision grâce à une connaissance de la situation en temps réel.
La technologie promet également de permettre des approches plus intégrées de la surveillance sanitaire. Les futurs systèmes pourraient relier les données relatives à la faune sauvage, au bétail et à l’environnement afin de suivre les menaces émergentes en temps réel, favorisant ainsi le type de collaboration intersectorielle qu’exigent les approches « Une seule santé », mais que les frontières institutionnelles empêchent souvent de mettre en place.
Toutefois, pour réaliser ce potentiel, il convient d’accorder une attention particulière à la manière dont le développement et la mise en œuvre de l’IA se déroulent. « Si l’IA n’est pas développée en collaboration avec des professionnels de la médecine vétérinaire intégrés dans des équipes transdisciplinaires, elle risque de renforcer des approches étroites, axées sur le profit et déconnectées des véritables besoins et réalités de la société », prévient Walzer.
L’IA nous permet de surveiller les maladies de la faune sauvage sans dépendre uniquement de l’échantillonnage actif sur le terrain, ce qui rend la surveillance plus complète et plus efficace en termes de ressources.
Terra Kelly
Gouvernance éthique et approches réglementaires
À mesure que les applications de l’IA dans le domaine de la santé animale gagnent en maturité, les questions de gouvernance et de réglementation deviennent de plus en plus cruciales. Les experts interrogés font état d’approches variées pour garantir une mise en œuvre éthique et efficace de l’IA, reflétant à la fois la diversité des applications et la nature évolutive des cadres réglementaires.
Certaines organisations mettent l’accent sur la transparence et l’explicabilité de leurs systèmes d’IA. « Nous adhérons aux principes de transparence, de traçabilité et d’explicabilité », indique Hansen. « Nos clients sont encouragés à soumettre les résultats de l’IA à une validation humaine et à des scénarios de simulation de crise. »
D’autres mettent l’accent sur une validation rigoureuse et une supervision par des experts. Les chercheurs universitaires mettent l’accent sur « la validation croisée rigoureuse, l’examen par des experts des résultats des modèles et la validation dans le monde réel », explique Pandit, y compris les enquêtes sur le terrain des alertes générées par l’IA pour s’assurer qu’elles correspondent à des événements sanitaires réels.
Dans le cadre de la recherche collaborative, les approches de gouvernance mettent souvent l’accent sur l’équité et l’inclusion. « Nous suivons les principes de la science ouverte et donnons la priorité aux principes des données FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) et à l’examen éthique », explique Walzer. « La gouvernance collaborative avec les partenaires autochtones et locaux et la gestion des données CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics) sont des principes fondamentaux. »
Le défi consiste à trouver un équilibre entre l’innovation et la responsabilité. Walzer ajoute qu’« il est nécessaire de tempérer l’élan entourant l’IA par un investissement réfléchi dans la gouvernance éthique, la formation du personnel et la coordination intersectorielle ».
La plus grande valeur ne viendra pas de l’automatisation seule, mais de la façon dont l’IA complète le jugement humain et aide à intégrer la prévoyance à long terme dans les systèmes de santé animale.
Jens Hansen
Conseils pour les futurs adoptants
Pour les organisations qui envisagent d’adopter l’IA dans le domaine de la santé animale, les experts donnent des conseils pratiques fondés sur leur expérience. Le thème principal est de commencer petit, mais dès maintenant, tout en se concentrant sur les considérations éthiques et l’expertise humaine.
« Commencez par de petits cas d’utilisation ciblés où l’IA peut clairement augmenter, et non remplacer, l’expertise humaine », conseille Hansen. « Privilégiez les partenariats qui combinent la science des données, les connaissances vétérinaires et la prospective stratégique ».
L’importance de la collaboration est un thème récurrent. « Il est important de collaborer étroitement avec les experts du domaine pour s’assurer que les modèles d’IA sont ancrés dans le contexte du monde réel », note Kelly. Cette collaboration devrait aller au-delà du développement technique et inclure les personnes les plus concernées par les problèmes que l’IA cherche à résoudre.
« Veillez à ce que les personnes les plus proches du problème participent à l’élaboration de la solution », recommande Walzer. « N’attendez pas d’être invité à la table de l’IA, prenez une chaise ».
Les conseils mettent également l’accent sur la nature itérative du développement de l’IA. « Préparez-vous à un développement itératif, en particulier lorsque vous travaillez avec des données complexes », conseille Kelly. Cette approche itérative exige de la patience et un investissement soutenu, mais elle est essentielle pour développer des outils qui fonctionnent de manière fiable dans le monde réel.
Plus important encore, les experts soulignent la nécessité d’efforts éducatifs pour aider les utilisateurs à comprendre et à faire confiance aux outils d’IA. « Pour faire progresser ce domaine, il faut une collaboration interdisciplinaire, des protocoles normalisés et des efforts de formation qui aident les utilisateurs à comprendre intuitivement et à faire confiance à l’IA dans le cadre de leurs outils de diagnostic et de surveillance », observe Pandit.
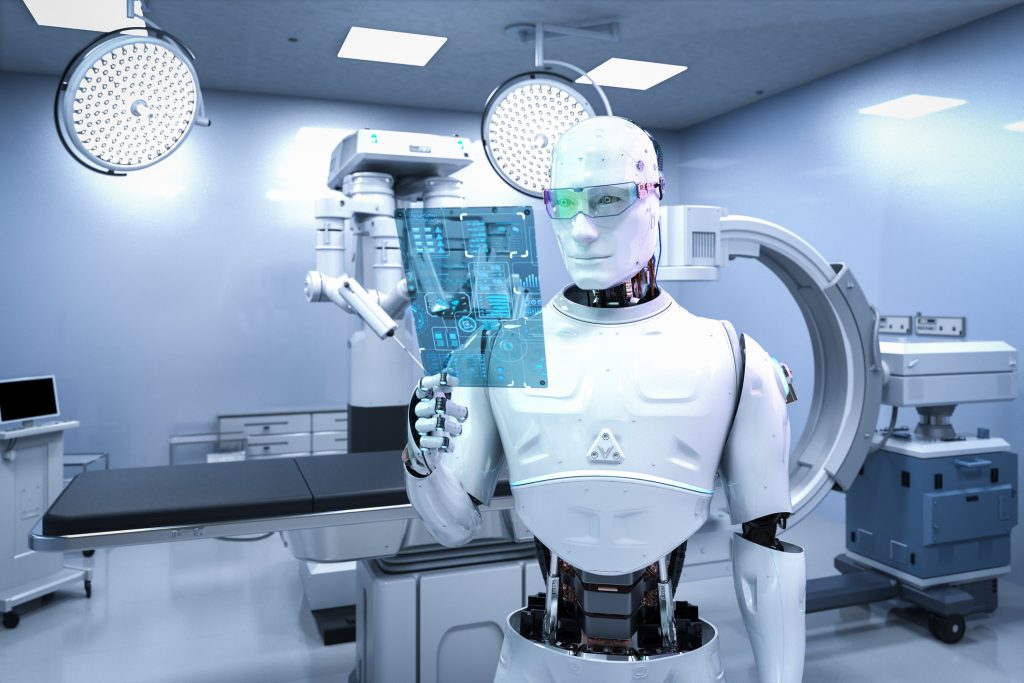
©PhonlamaiPhoto
Un avenir fondé sur la collaboration
La révolution de la santé animale par l’IA n’est pas une promesse lointaine, mais une réalité actuelle, comme en témoignent les plateformes qui détectent déjà des schémas de maladies à travers les continents et les outils d’IA qui accélèrent la recherche et l’élaboration de politiques. Pourtant, l’expérience des experts révèle que l’impact final de la technologie ne dépendra pas uniquement de la sophistication des algorithmes, mais de la manière dont nous intégrerons ces outils à l’expertise humaine et à la gouvernance éthique.
La voie à suivre nécessite ce que Walzer appelle des « engagements éthiques clairs » combinés à une « collaboration transdisciplinaire ». Elle exige que nous relevions les défis fondamentaux de l’inégalité des données tout en construisant des systèmes d’IA visant à renforcer, plutôt qu’à supplanter, le jugement humain. Plus important encore, il faut s’assurer que les personnes les plus proches des défis de la santé animale – des vétérinaires ruraux aux communautés autochtones – participent à l’élaboration des solutions, ajoute-t-il.
Alors que le changement climatique s’accélère et que l’interconnexion mondiale accroît les risques de transmission des maladies, le besoin d’approches prédictives et intégrées de la santé animale devient de plus en plus urgent. L’IA offre des capacités sans précédent pour relever ces défis, à condition que nous construisons ces systèmes avec le même soin que nous espérons voir déployé au bénéfice des animaux dont nous avons la charge.
L’avenir de la santé animale ne consiste pas à choisir entre l’expertise humaine et l’IA, mais à créer entre elles des partenariats qui servent l’objectif plus large de la santé de la planète. Dans cet avenir, l’aigle présentant des signes neurologiques ne sera pas seulement un patient à traiter, mais un signal d’alerte précoce dans un système mondial de surveillance de la santé qui protège à la fois la faune sauvage, le bétail et les humains.
Copyright de l’image principale : Tanit Boonruen
Traduit de l’original en anglais par DeepL et révisé par des humains










